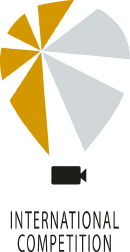En choisissant douze pays arabes du Moyen-Orient d’Asie, ayant la même culture de base modelée par la langue et l’Islam, pouvions nous espérer une unité dans un art qui reflète la modernité et l’évolution différente de ces pays, d’autant plus, que nous avons privilégié les cinéastes-auteurs qui introduisent dans les films leurs préoccupations et leur sensibilité personnelles ?
Seule une lecture historique permet parfois de rapprocher ce que l’espace sépare. Bien sûr, pour les longs métrages de fiction qui ici nous intéressent, cette lecture qui commence en 1931 pour finir à nos jours, ne concerne que six pays sur douze. Les vingt-quatre films que nous avons sélectionnés témoignent donc, à un instant donné, des préoccupations culturelles, esthétiques et idéologiques de chacun des auteurs, inscrites dans celles de leur pays. Que pouvons-nous constater ? par exemple qu’un même mouvement de création de cinéma d’auteur a traversé au début des années soixante-dix tous les pays du Moyen-Orient produisant des films, sauf paradoxalement le Liban. La conjonction d’une politique gouvernementale de production et la naissance de cinéastes – influencés indirectement par les nouvelles vagues qui déferlaient sur le monde entier dans les années soixante – a abouti à des créations originales, celles-ci restent encore parmi les plus intéressantes, en Syrie, en Irak et au Koweit. Curieusement au Liban, pourtant traditionnellement tourné vers l’Europe, particulièrement vers la France, la Nouvelle Vague n’a pas su à cette époque renouveler les premiers cinéastes inspirés des années cinquante. Conjoncture culturelle, idéologique et politique, il aura fallu les années de guerre pour que l’énergie de la lutte se transfère dans la création cinématographique, comme d’ailleurs en Palestine (contrairement à l’Irak où la guerre et la situation politique ont sclérosé la création et mis fin à celle-ci).
Aujourd’hui, avec la fin de la guerre et une liberté de pensée retrouvée, cette énergie se poursuit avec l’apparition de jeunes auteurs et la naissance à Beyrouth de quatre écoles de cinéma. On peut espérer des lendemains qui chantent pour la création cinématographique au Liban, mais aussi dans toute la région, tant l’intérêt pour le cinéma y est grand. Il en est ainsi dans la péninsule arabique où des réalisateurs de télévision écrivent des histoires et rêvent de faire des films pour le cinéma, pourvu qu’un support de production vienne appuyer leur projet. Cinéma d’hier ici, cinéma d’aujourd’hui là, cinéma de demain, ici, là et ailleurs, le Moyen-Orient reste en mouvement.
Philippe Jalladeau
Irak
Il n’existe pas en Irak de bases cinématographiques réelles quand le secteur privé a entrepris de développer une production dans ce domaine. Contrairement à certains pays arabes, on observe une grande léthargie en Irak du côté de la création : par exemple aucune place n’est faite aux techniques de l’audio-visuel dans les structures de l’enseignement. La création du «Centre de documentation du théâtre et ducinéma» en 1945 marque les débuts de la production cinématographique en Irak. Cette initiative privée permet en 1945 la coproduction avec l’Egypte du film «Le Caire-Bagdad». Pendant plusieurs années, la production cinématographique n’est pas spécifiquement irakienne mais le résultat d’une collaboration avec d’autres pays arabes. On peut noter ainsi au Caire, les films Fils de l’Orient(1944) et Layla d’Irak (1949) par Ahmed Kamil Moursy, produit en collaboration avec le Liban et l’Egypte. Ce dernier film est cependant tourné en Irak dans le premier studio de cinéma, dit «studio de Bagdad».
Cette production n’a pas vraiment de caractéristiques locales et subit l’influence des cinémas libanais et surtout égyptiens, plus développés. La production de cette époque est essentiellement commerciale, les cinéastes et producteurs considèrent alors le cinéma comme un moyen de profit.
Entre 1945 et 1950, on ne peut pourtant pas invoquer l’absence de moyens de production pour excuser la faiblesse de la création. Créé en 1948, ce studio possède les équipements les plus modernes du mondes arabe. Les Turcs exploitent ce studio bénéficiant des techniques modernes, d’une main d’oeuvre bon marché et compétente. Arguant des principes de la collaboration, ils produisent les films comme Thaîr et Zahra ou Arza et Kanbar, films turcs n’ayant aucune attache avec l’Irak.
Avant l’établissement du secteur public, le cinéma irakien produit quelques films importants comme «Saïd Affendi» de Kariman Hosni ou «Qui est responsable» de A.J. Wali.
Le secteur public : 1958-1968
En 1959 l’établissement du premier «Organisme du cinéma et du théâtre» est créé à peine un an après la révolution de juillet 1958. Cependant, l’entrée en action du secteur public n’arrête pas celle du secteur privé. Différentes personnes poursuivent des recherches esthétiques et idéologiques parallèlement à l’activité politique alors en pleine effervescence et contribuent ainsi à donner à l’histoire du cinéma irakien la plupart de ses films de qualité comme Al-Hâris (Le gardien) de Kalil Chowky en 1967.
Ensuite le secteur privé produit surtout des films de série noire, des comédies, des mélodrames et des westerns de qualité médiocre, purement commerciaux comme Souvenirs, La Famille médiocre, La Nuit de la douleur. Parallèlement, le secteur public ne produit que des courts métrages de propagande pour l’Etat. Dans ce contexte, il faut attendre 1966 pour voir la réalisation du premier long métrage financé par des fonds publics : Le Contrôleur de Jaafar Ali. L’organisme produit également en 1968 Le bien, véritable recueil de chansons et des danses, film très critiqué par les intellectuels. Le service public n’est donc pas efficace à cette époque à cause des conditions politiques et socio- économiques. En fait l’expérience du secteur public possède dès le début des bases mal adaptées : la production cinématographique est rattachée à plusieurs ministères, et leur seul but est de produire des courts métrages de propagande.
Développement d’un production effective : 1968-1988
A partir des années 70, le cinéma irakien acquiert une ampleur nationale et un niveau technique satisfaisant. Cette période connait des changements politiques importants avec la révolution de 1968 menée par le parti BAAS, quiapporte un remaniement des structures.
L’organisme du cinéma et du théâtre réalise sa troisième et dernière production en 1969 avec Le Pont al-ahrar par Diya Al-Bayati, avant de céder la place en 1972 à l’établissement public du cinéma, du théâtre, de la radio et de la télé- vision.
Entre 1968 et 1978, le secteur privé produit quatre films : Le Virage et Les Années de la vie de Jaffar Ali, Les Nuits de Bagdad de Borhan Al-Din Jassim, Le Bateau de Adnan Al-lmam. Mais deux films seulement sont projetés dans les salles de Bagdad : Le Virage et Le Bateau . La production privée s’affaiblit à cette époque, essentiellement à cause de problèmes financiers.
De son côté le nouvel organisme public produit en 1972 Les Assoiffés de Mohamed Choukri Jamil puis L’Arme noire du même auteur dont le tournage est interrompu.
En 1975, une loi institue la séparation entre l’organisme public du cinéma et du théâtre d’une part, et celui de la radio et de la télévision d’autre part et apporte au cinéma une politique de développement cohérente.
Parmi les films réalisés après 1975, on peut retenir Maison dans cette ruelle (1977) de Qassim Hawal qui met en scène un journaliste «justicier» dans l’Iraken crise de 1967 et «Le Fleuve film engagé de Fayçal Al-Tohami. En1981, Salah Abou Seif tourne en Irak Al-Qadissiya le film fétiche du pays en guerre contre l’Iran qui décrit la grande bataille de Qadissiya. En 1988, Karlo Hartyon réalise Un peu de force sur fond de guerre Iran-Irak.
En 1992, le nombre de films produits s’élève à 99, date à laquelle la production cinématographique s’arrête à cause de l’embargo. Seulement cinq films documentaires (courts métrages) ont été produits depuis décrivant la souffrance du peuple irakien.
Jordanie
II n’existe pas de cinéma de long métrage jordanien. On ne peut qu’évoquer ici-et-là des tentatives, espacées dans le temps, entreprises par des cinéastes. Ces amateurs de cinéma étaient dépourvus de l’expérience nécessaire, ou de la culture cinématographique et encore davantage des moyens financiers appropriés. Le cinéma est un phénomène assez récent en Jordanie, il s’est progressivement développé dans les principales villes du pays qui possèdent des salles de spectacle spécialisées dans la projection de films égyptiens, indiens ou américains.
On peut découper l’histoire du cinéma en trois époques. La première qui s’étend de 1957 à 1969 est celle qui précède la création de la télévision jordanienne. La seconde de 1970/1971 est la période où la télévision jordanienne se lance dans la production de quelques longs métrages en format 16mm. La troisième période est la réalisation d’un long métrage en 1991.
Lutte à Jerash – 1957
On ne connaît pas avec précision l’identité du réalisateur de ce film qui est considéré comme le premier long métrage jordanien. Un groupe de cinéaste amateurs a pris part à sa réalisation. Bien qu’Ibrahim Sarhan en ait revendiqué la paternité, ce film n’aurait pas pu voir le jour sans l’apport technique essentiel de Sobhi el Naggar, ouvrier fraiseur qui s’était pris de passion pour le cinéma en réparant les appareils de prise de vue et de projection. Avec des moyens rudimentaires et beaucoup d’esprit d’invention il a mis sur pied un laboratoire de développement et une table de montage. Il a dû inventer un procédé pour assurer le synchronisation de l’image et du son. Le film débute par une séquence documentaire sur la Palestine et Jérusalem. Mais l’histoire relate l’histoire d’une bande de trafiquants d’antiquités du côté de Jerash aux prises avec la police.
Ma patrie adorée -1962
Le film est réalisé par un cinéaste amateur, Mahmoud Kawash. Il s’agit d’une imitation de mélo- drames amoureux égyptiens qui se déroule sur fond de conflit israélo-arabe. Le héros du film abandonne sa fiancée pour aller combattre en Palestine.
Tempête à Petra – 1968
Film réalisé par le metteur en scène libanais Farouk Agrama, c’est une coproduction libano-jordano-italienne qui relate les faits d’une bande de trafiquants d’antiquités qui sont poursuivis par Interpol.
La Lutte jusqu’à la libération – 1968
de Abdel Wahab el-Hindi, ce film présente de façon assez naïve les actes d’héroïsme de la résistance palestinienne contre l’armée israélienne.
La Route de Jérusalem -1969
de Abdel Wahab el-Hindi, terminé par Taïssir Aboud. Le film relate l’histoire d’un étudiant à l’université qui abandonne ses études en Egypte pour rejoindre la résistance pour venger la mort de son ami.
Les Serpents -1970
de Galal Toamé, film produit par la télévision jordanienne en format 16mm. Une histoire de triangle amoureux où le mari provoque une fin tragique.
Une histoire orientale – 1991
réalisé par Nadjat Anzour, un film en 16mm qui mêle le fantastique et la réalité à travers la personnalité d’un journaliste écrasé par les difficultés de la vie quotidienne. Il se voit propulsé au rang de héros après avoir sauvé les passagers d’un bus.
En plus de ces films, on peut citer trois tentatives de coproductions avec la Turquie qui a exploité les paysages naturels et les sites archéologiques jordaniens. Ces films sont L’aigle d’Orient (1971), Un homme de Jordanie (1984), L’Homme de loi (1984), ces films tournés en turc n’ont jamais été projetés en Jordanie.
Adnan Madanat
Les pays du Golfe
Le cinéma des pays du Golfe n’est aujourd’hui confronté qu’à un seul problème principal : le manque d’intérêt. Les huit pays et Etats du Golfe —Arabie Saoudite, Koweït, Bahreïn, Emirats arabes unis, Oman, Qatar, Yémen et Irak — connaissent la crise du «manque d’intérêt». Les secteurs public et privé en sont responsables à parts égales. Cette absence d’intérêt pour le fonctionnement d’une industrie cinématographique dans cette région du monde est la cause essentielle de l’absence de tout financement. En conséquence, la quantité de films réalisés depuis environ trente ans reste négligeable.
Pourtant, on notera que chacun des pays de la région s’est intéressé au problème de manières variées au fil des ans et on compte aujourd’hui quelques figures qui tentent de faire l’impossible, c’est-à-dire faire des films.
Au Koweït par exemple, Khalid Siddik est entré dans l’histoire en réalisant Bas ya Bahr en 1972, très belle fable en noir et blanc sur les hommes, les femmes, la mer et la société. Bien que le premier film de fiction koweïtien ait été tourné sept ans plus tôt (le très méconnu The Storm de Mohammed Al-Sanousi), Bas ya Bahr marque la naissance du cinéma koweïtien. D’autres films furent réalisés par la suite, dont deux signés Khalid Siddik, mais aucun ne renouvela ce premier succès international.
A Bahreïn, Bassam Al-Zeidi, diplômé d’une école de cinéma au Caire en 1982 et qui travaille aujourd’hui encore pour la télévision, brisa le silence avec The Barrier en 1990. Dans les Emirats arabes unis, les tentatives se limitèrent à quelques courts métrages, situation analogue au Qatar, au Yémen et à Oman. Mais en Arabie Saoudite, Abdullah Moheissin parvint à rompre la tradition en s’imposant avec succès sur la scène arabe en tant que documentariste : il a à son actif trois longs métrages documentaires réalisés dans les années quatre-vingt, ainsi qu’un court métrage d’animation.
Quant à l’Irak, la guerre a mis un terme à une période très prolifique. Le cinéma irakien est né dans les années quarante et cinquante. La fréquentation des salles de Bagdad était la plus forte des villes arabes, conséquence de l’ouverture de la société irakienne. Après l’arrivée au pouvoir du parti Baas, une fondation publique du cinéma fut instituée : elle produisit de nombreux films de toutes sortes, mais la plupart ne furent que des outils de propagande.
Bien que la guerre du Golfe ait affecté de nombreux pays de la région (mais pas tous), le fait que les populations locales n’aspirent à aucun changement culturel profond constitue un véritable problème. Les produits américains et égyptiens répondent aux attentes des spectateurs qui ne semblent guère se soucier de voir leurs cinémas nationaux présentés à parts égales sur les écrans.
Ces dernières années, de nouvelles salles de cinéma ont ouvert leurs portes au Qatar, au Koweït, dans les Emirats arabes unis et à Bahreïn, mais elles ne laissent entrer que des produits hollywoodiens. Les distributeurs nationaux n’ont pas d’hésitation quant à ce qui est commercialement viable, tandis que les investisseurs ne se pressent pas pour investir dans une industrie dont ils ignorent tout. En outre, le nombre de spectateurs habitués à regarder un film (ancien ou relativement récent) à la télévision s’est accru avec l’expansion récente des chaînes de télévision par satellite.
Dans un tel contexte, les cinéastes, qui ont pour la plupart appris le cinéma aux Etats-Unis ou en Egypte sans être parvenus à s’imposer dans leur pays, ont fondé une association pour la promotion et la réalisation de leurs films dans la région. Abdullah Moheissin en a pris la tête et elle compte parmi ses membres Bassam Al-Zowadi. Cette association se donne pour but la production collective de films, mais ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour y parvenir.
Le facteur très encourageant vient de la nouvelle génération d’intellectuels du cinéma, les lecteurs d’ouvrages théoriques et critiques sur le cinéma et les amateurs de bons films, quand bien même ils ne peuvent les voir qu’en vidéo. Certains ont exprimé le souhait de pouvoir découvrir des films du monde entier, pas uniquement sortis des usines hollywoodiennes ou cairotes. Il est à espérer que tous ces éléments dispersés réussissent à se rassembler dans un avenir proche, afin de faire naître un vrai cinéma du Golfe. Si sa taille peut rester modeste, il aura néanmoins besoin des efforts collectifs de tous les participants.
Mohammed Rouda
Traduit de l’anglais par Jean-François Cornu
Liban
Si les origines du cinéma libanais remontent au début des années trente avec la réalisation des Aventures d’Alias Mabrouk, premier long métrage libanais, le cinéma du Liban n’a connu qu’une activité réduite et sporadique. Il va sans dire que le Liban dispose des talents, de la culture, de la nature et de l’ambition de faire des films. Il lui manque cependant les sources de financement essentielles, qu’elles proviennent de l’Etat ou d’entités privées.
Après l’indépendance en 1941, un certain nombre de films ont également été produits. Il s’agissait, en général, avant tout de comédies, et de drames romantiques, chacun de ces genres étant motivé par le désir de toucher un public de masse sur le modèle du cinéma égyptien. Dans les années cinquante et au début des années soixante, on produisit de nouveaux films libanais qui se démarquèrent du schéma égyptien, mais ils n’eurent guère d’impact commercial. La critique accueillit favorablement certains d’entre eux, comme Le Poison blanc, film policier destiné à prévenir le public des dangers de la drogue. Georges Nasser présenta Où ça ? comme le tout premier film d’art et essai libanais.
On tenta également avec sincérité, mais en vain, d’adapter Les Ailes brisées de Khalil Gibran au cinéma.
Au milieu des années soixante, le contexte cinématographique libanais connut un bouleversement. En Egypte, Gamal Abdel Nasser nationalisa les infrastructures nationales et de nombreux producteurs et financiers se précipitèrent en masse au Liban pour y produire leurs films. Plus de trente films furent réalisés en moins de cinq ans, mais la plupart étaient des produits de consommation courante dans la traditionnelle veine du cinéma commercial égyptien, confectionnés par des metteurs en scène et des acteurs égyptiens, parlant avec l’accent égyptien. Après cette embellie, les réalisateurs égyptiens retournèrent au Caire, suivis par de nombreux bailleurs de fonds libanais désireux de produire des films égyptiens. Ceux-ci restèrent au Caire jusqu’au début des années quatre-vingt, où ils dominèrent le secteur privé du cinéma égyptien en monopolisant la distribution des films réalisés en Egypte.
La fin des années soixante et le début des années soixante-dix représentent une période cruciale du cinéma libanais. Au cours de cette période qui précéda la guerre civile, nombre de films s’intéressèrent à la situation politique. L’une des tendances principales de ce cinéma se caractérisa par le traitement de la cause palestinienne. Si la plupart ne relevait que de la catégorie des films d’action où le contexte politique n’est qu’un prétexte, ils jouèrent néanmoins tous un rôle quant au problème de la guerre israélo- arabe.
Pendant la guerre civile qui se déclencha en 1975, deux types de films virent le jour : des films qui ignoraient la situation du pays, d’autres qui évoquaient directement la guerre et son impact sur la société libanaise. Tandis que Maroun Baghdadi attirait l’attention du cinéma mondial (et du cinéma français, en particulier) avec des films comme Les Petites Guerres et L’Homme voilé, d’autres cinéastes s’exprimaient médiocrement, et à usage interne, sur la guerre : parmi ces derniers, citons Rafik Hajjar (The Hideaway) et Borhan Alawiah (Beirut-The Counter). Boran Alawiah eut la possibilité de se rendre en Europe, mais ses efforts cinématographiques restèrent limités.
Aujourd’hui, le cinéma libanais est parvenu à un carrefour, mais il ne sait quelle direction prendre : d’un côté, on compte de nombreux jeunes cinéastes qui réalisent courts et longs métrages, aussi bien documentaires que de fiction. De l’autre, et malgré une production moyenne de deux longs métrages par an depuis 1993, la question du financement demeure le problème principal. Beaucoup de cinéastes sont dans l’impossibilité de tourner des scénarios qui n’attendent plus que ça. West Beirut, dans lequel Ziad Doueiri traite la gravité de la guerre avec ironie, est l’un des rares succès commerciaux, tant aux niveaux national qu’international, des sept dernières années.
Mohammed Rouda
Traduit de l’anglais par Jean-François Cornu
Palestine
L’histoire du cinéma palestinien
Le long métrage palestinien apparaît dans les années soixante-dix avec le film de Kassem Hawel : Le Retour à Jaffa. Après le déplacement du lieu d’activité du cinéma palestinien, on assiste à son épanouissement avec les films de Michel Khleifi puis Rachid Masharawi et Elia Suleiman et Ali Nassar.Les débuts se situent en fait dans les années 40. la ville de Jaffa en était le centre. Des salles de cinéma se créent comme le cinéma «Al-Hamra». On sait que plusieurs tentatives de longs métrages ont eu lieu à Jaffa. On a recueilli des témoignages de personnes aujourd’hui âgées de 70 ans qui ont participé comme comédiens à des films tournés à l’entrée de la vieille ville de Jérusalem, comme par exemple Jamal Al Asfarou Ahmed Hilmi Alkilani. Le film Le Rêve d’une nuit, sans doute le premier long métrage palestinien, a été tourné en Palestine en 1948. Ce film cité par Georges Sadoul dans L’histoire du cinéma dans les pays arabes a pu être vu au Cinéma Al Patra à Amman, comme l’indique l’historien du cinéma palestinien Hassan Abou Ohnreimeh dans un article, au début des années 70.
Cependant, il a été considéré comme film égyptien, car le nom de son réalisateur, Salah Baderkhan, prêtait à confusion avec celui de plusieurs réalisateurs égyptiens encore en activité de nos jours. Hassan Abou Ohnreimeh affirme que Salah Baderkhan est un Palestinien qui outre ce film, en aurait réalisé d’autres.
Dans les années 60 et 70, le cinéma palestinien apparaît en Jordanie. Il suit au Liban l’Organisation de Libération de la Palestine. L’Organisation de Libération a créé une section cinéma dans la section culturelle. Plusieurs organismes, comme le F.P.P.L.P., F.P.L.P. ont réalisé plusieurs documentaires. Au début, le cinéma a contribué au renouveau de la résistance palestinienne. Ensuite, les rapports avec le pays se font à travers la mémoire. Le désir de revoir leur patrie est fort comme la force du dénuement imposé par Israël. Pour cette raison, plusieurs réalisateurs tels que Ghaleb Shaath La Clef, Kais Zubeidi Le Pays aux fils barbelés) ont utilisé comme matière première des films que des équipes européennes ont tourné en Palestine avec leur accord. En 1980 sort le premier film de Michel Khleifi, La Mémoire fertile. C’est la première fois qu’un réalisateur palestinien filme lui-même son pays. Ce film a été le signal du déplacement du centre de gravité du pays, que l’on retrouve dans ses trois autres films comme Noce en Galilée, Le Cantique de la pierre, Conte des trois diamants. Tous ces films sont allés au-delà des problèmes, des catastrophes et de la nostalgie du pays. Ils se sont immergés dans la société palestinienne pour mieux ressentir les problèmes des différentes générations et de tous les courants de pensée.
Puis, Rachid Masharawi, Elia Suleiman et Ali Nassar ont suivi, mais apparemment il y aurait depuis un ralentissement de la réalisation de long métrage car Michel Khleifi n’en a pas tourné depuis 1994 et Rashid Masharawi depuis 1995. Elia Suleiman qui n’a tourné qu’un seul long métrage se bat pour faire son second film.
Le financement de ces films provient en majorité de l’Europe, mais il semble que l’Europe a d’autres priorités ou croit que les Palestiniens vivent une période de paix, depuis les accords d’Oslo, leur permettant de se prendre en charge eux-mêmes.
En tous cas, en Palestine, une nouvelle génération de cinéastes voit le jour, ils utilisent la vidéo comme moyen d’expression. Ils tournent des documentaires, certains veulent rester dans ce registre comme Azza Al-Hassan et Nizar Hassan et d’autres attendent l’opportunité de faire un long métrage comme Subhi Zubeidi.
Les autorités palestinienne ont d’autres priorités que le cinéma. La télévision palestinienne a été très décevante après les accords d’Oslo et est très loin d’aider la production cinématographique. Mais l’éveil du cinéma prend de l’ampleur, les universités commencent à créer des options «Media» et certaines d’entre elles s’orientent vers le cinéma et la télévision. Un grand nombre d’étudiants s’inscrivent dans cette discipline, et, pour cette raison, nous espérons que le déclin sera de courte durée.
Georges Khleifi
Traduit de l’arabe par Maher Anjari